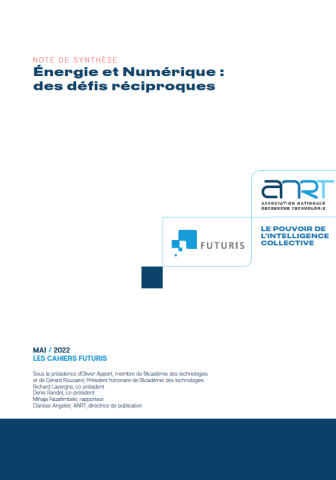Les technologies numériques constituent un levier indispensable à la transition énergétique. Le développement d'outils numériques adaptés accompagne la décarbonation de l'économie dans de nombreux secteurs clés. L'empreinte environnementale du numérique n'est cependant pas neutre et varie selon les pays. Toute la question réside dans l'équilibre bénéfice/coût. Or le calcul des coûts énergétiques du numérique n'est pas facilement accessible.
De plus, si pour les secteurs traditionnels, la consommation électrique est toujours un facteur du prix de revient final, elle n'est jamais bloquante. En revanche, pour le numérique, cela devient un problème majeur, car les contraintes de dissipation de chaleur limitent les performances. Il va falloir désormais s'orienter vers d'autres solutions que les microprocesseurs universels standardisés. Cela remettra en cause la séparation entre la conception des systèmes et celle des processeurs universels qui les servent, et bouleversera toute la chaine de valeurs. Désormais les constructeurs de systèmes devront aussi maitriser la conception de leurs processeurs dédiés, au risque que d'autres acteurs les supplantent, à l'instar de ce qui s'est passé pour les plateformes B to C. Cela annoncent des opportunités mais aussi des risques industriels sérieux. Les besoins de R&D et de compétences sont urgents.En 2022, les travaux du groupe de travail consacré à la Stratégie nationale de recherche pour l'énergie aboutissent aux recommandations suivantes :• cerner la consommation du secteur numérique par une approche globale avec une standardisation des méthodes de mesures ;• investir massivement en R&D et en ressources humaines pour faire coopérer très étroitement les concepteurs de systèmes, de composants et les architectes informatiques ;• construire une solidarité européenne afin de faire valoir nos atouts alors que des positions stratégiques peuvent être engagées.